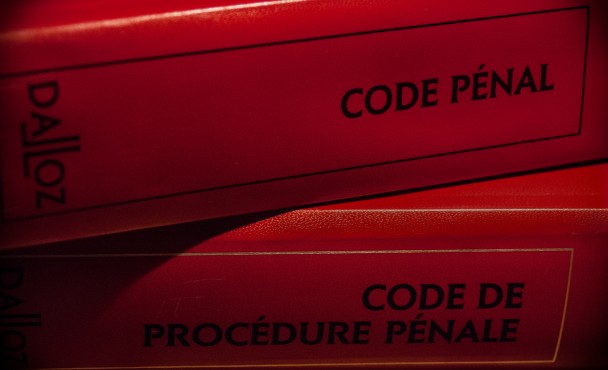Les députés examinaient ce jeudi 12 janvier en deuxième lecture la proposition de loi de réforme de la prescription pénale. Celle-ci, dans le but affiché d’harmoniser des délais de prescription complexifiés par les réformes des dernières années, tend en réalité à instituer une quasi imprescribilité de l’action publique.
La prescription est pourtant l’un des principes fondamentaux de notre système de droit pénal. Elle est fondée sur le « droit à l’oubli » qui est une nécessité de toute société démocratique et sur la réalité du dépérissement des preuves au fil des années. Ces deux fondements, remis en cause par cette proposition de loi, ne sont pourtant pas obsolètes.
Si la prescription est aujourd’hui un système complexe c’est en raison des multiples dérogations introduites par le législateur pour prendre en compte les spécificités de certains crimes et délits. C’est le cas des crimes et délits sexuels sur mineurs qui ont déjà une prescription deux fois plus longue et ne démarrant qu’à la majorité de la victime. La proposition de loi ne modifie pas les modalités de la prescription pour ces crimes et délits.
Pour tous les autres crimes et délits, à l’exception des crimes et délits sexuels sur majeurs qui auraient dû faire l’objet d’un débat spécifique, la tendance à l’allongement est en réalité une mauvaise réponse à une vraie question : celle de l’efficacité de notre justice.
Oui, la réponse pénale peut être lente, mais c’est davantage en raison du manque chronique d’effectifs et de moyens dont souffre la justice en France. Ne nous trompons pas de combat. Une telle réforme va à l’encontre du droit pour chacun d’être jugé dans un délai raisonnable.