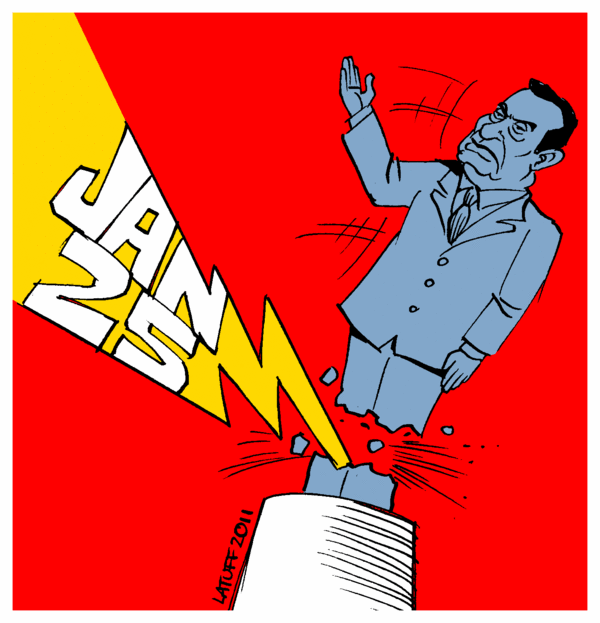Il n’était pas concevable de s’interroger autant sur les transitions démocratiques en cours – et plus particulièrement en Afrique du Nord – et ne pas plonger quelques jours au moins dans l’Égypte post-Moubarak. Si l’Égypte occupe une place géostratégique majeure, elle peut devenir un acteur politique et économique déterminant… à la condition qu’un grand dessein national, aujourd’hui absent, y contribue. Le compte-rendu qui suit peut sembler pessimiste, en particulier du fait de ses inter-titres. En réalité, il y a bien des raisons de rester optimiste : une révolution n’est pas un fleuve tranquille. Elle connaît – et c’est le cas en Égypte – des phénomènes contre-révolutionnaires, mais il existe aussi une citoyenneté active, en plein éveil et qui n’est pas prête de sacrifier son droit à la libre parole. Néanmoins, il m’a semblé utile de mettre l’accent sur des inquiétudes, sur des fragilités et sur des risques, aussi, d’étouffement de la transition démocratique. J’espère que mes amis égyptiens me le pardonneront et me rejoindront dans le pari de la jeunesse que j’évoque à la fin.
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce déplacement – malheureusement trop court – et en particulier à toute l’équipe de notre ambassadeur, M. Galey.
Liberté d’expression et désillusion politique
Si ce grand pays (82 millions d’Égyptiens – 92 si on compte la diaspora – soit 1 arabe sur 5) n’est pas comparable à la Tunisie, certaines caractéristiques communes m’ont frappé :
![]() en premier lieu, l’incroyable liberté d’expression encore inimaginable il y a 18 mois qui dynamise une presse qui n’a de limite que son modèle économique encore fragile. Internet, en arabe et en anglais, est complètement démocratisé et le réseau très complet, tout comme la téléphonie mobile (il y a plus de cartes SIM en Égypte que d’Égyptiens). Les difficultés pour le Président Morsi à circuler en Égypte sans être contesté par la rue sont de plus en plus fréquentes. Bref, l’acquis principal de la révolution citoyenne est manifestement la liberté d’expression publique (même si les tentatives d’intimidation existent) ;
en premier lieu, l’incroyable liberté d’expression encore inimaginable il y a 18 mois qui dynamise une presse qui n’a de limite que son modèle économique encore fragile. Internet, en arabe et en anglais, est complètement démocratisé et le réseau très complet, tout comme la téléphonie mobile (il y a plus de cartes SIM en Égypte que d’Égyptiens). Les difficultés pour le Président Morsi à circuler en Égypte sans être contesté par la rue sont de plus en plus fréquentes. Bref, l’acquis principal de la révolution citoyenne est manifestement la liberté d’expression publique (même si les tentatives d’intimidation existent) ;
![]() on assiste, comme en Tunisie, à une critique plus affirmée des islamistes au pouvoir : aux caricatures et articles de presse viennent s’ajouter de nombreuses contestations sociales. En effet, le gouvernement n’apporte pas de solution de redressement à une économie dont la crise frappe toutes les couches sociales. Les frères Musulmans reçoivent comme un boomerang le « programme en 100 jours » qu’ils avaient annoncé, et qui assurait en particulier que l’Égypte pourrait injecter des liquidités dans l’économie à partir des « réserves » de Moubarak (« l’argent volé au peuple reviendra au peuple »). La notion de « démonstration négative » de l’islam politique au pouvoir est plusieurs fois revenue. Illustration de cette tendance, les élections étudiantes organisées suite à la révolution ont vu les Frères musulmans subir une sévère défaite, de même que dans les élections professionnelles de la presse. La désillusion est réelle : la population attend que le Président Morsi règle leurs problèmes quotidiens et non qu’il invoque si souvent la religion dans ses discours (références à l’histoire des Frères musulmans, justifications théologiques aux décisions gouvernementales, etc.) ;
on assiste, comme en Tunisie, à une critique plus affirmée des islamistes au pouvoir : aux caricatures et articles de presse viennent s’ajouter de nombreuses contestations sociales. En effet, le gouvernement n’apporte pas de solution de redressement à une économie dont la crise frappe toutes les couches sociales. Les frères Musulmans reçoivent comme un boomerang le « programme en 100 jours » qu’ils avaient annoncé, et qui assurait en particulier que l’Égypte pourrait injecter des liquidités dans l’économie à partir des « réserves » de Moubarak (« l’argent volé au peuple reviendra au peuple »). La notion de « démonstration négative » de l’islam politique au pouvoir est plusieurs fois revenue. Illustration de cette tendance, les élections étudiantes organisées suite à la révolution ont vu les Frères musulmans subir une sévère défaite, de même que dans les élections professionnelles de la presse. La désillusion est réelle : la population attend que le Président Morsi règle leurs problèmes quotidiens et non qu’il invoque si souvent la religion dans ses discours (références à l’histoire des Frères musulmans, justifications théologiques aux décisions gouvernementales, etc.) ;
![]() mais nous aurions tort de parier sur un affaiblissement durable des FM en Égypte : ils restent une force réellement organisée et structurée et il n’y a pas encore d’opposition démocratique alternative. Division et émiettement sont encore la marque de la scène politique égyptienne, d’autant que les forces démocratiques sont souvent débordées par une jeunesse revendicative mais désorganisée. La seule force qui progresse, c’est le doute.
mais nous aurions tort de parier sur un affaiblissement durable des FM en Égypte : ils restent une force réellement organisée et structurée et il n’y a pas encore d’opposition démocratique alternative. Division et émiettement sont encore la marque de la scène politique égyptienne, d’autant que les forces démocratiques sont souvent débordées par une jeunesse revendicative mais désorganisée. La seule force qui progresse, c’est le doute.
Pouvoir autoritaire, État faible
L’Égypte connaît une situation politique très spécifique, dominée, contrairement à la Tunisie ou au Maroc, par une majorité parlementaire islamiste absolue sous surveillance d’une armée encore puissante.
Cette surveillance – ainsi que la contestation grandissante – est d’autant plus forte que le Président Morsi est accusé de vouloir « frériser » l’État et l’administration (voire même l’armée). Cette dernière est d’ailleurs menacée de paralysie par une tendance diffuse de « déloyauté silencieuse » (les anciens fonctionnaires se sentent menacés et sur un siège éjectable, les Frères Musulmans ne cherchant pas à s’appuyer sur toutes les forces vives et compétentes de leur pays). La dernière réforme constitutionnelle est venue conforter cette crainte d’une tentation autoritaire du régime.
Dans une apparence de « normalité » (circulation, commerces, administrations, etc.), l’Égypte est traversée par un désordre généralisé, un équilibre très fragile dont le symptôme le plus apparent réside dans une absence : il n’y a plus de police dans les rues.
L’enjeu principal, pour les progressistes égyptiens, reste l’édification d’un État de droit bâti sur le principe de la séparation des pouvoirs. C’est aussi une préoccupation partagée par les étudiants que j’ai rencontrés (cf. infra), en particulier ceux de la filière juridique (IDAI). J’y ai vérifié notamment que, comme dans tous pays en transition, se posait la question de la justice transitionnelle pour juger notamment les policiers ayant tué durant la révolution, mais également toute personne jugée responsable des crimes de l’ancien régime…. C’est un sujet récurent dans la presse égyptienne, l’opinion s’interrogeant sur la nécessité, le bien fondé de punir – et selon quels critères, tenant compte de quels degrés de complicité ou de participation à un régime d’oppression, etc. Le débat judiciaire est d’autant plus central que les magistrats ont à exercer un rôle de stabilité durant la Révolution, et même de garde-fous face aux tentations autoritaires du Président Morsi. L’indépendance est un enjeu fondamental dans un pays dont le parquet cumule les fonctions d’instructions et d’accusations…
Économie sans tête
Économiquement la situation est devenue très difficile. Parmi les formules entendues lors de mon séjour, je retiens celle-ci : « les seules choses qui tournent en Égypte sont qataries ». De nouvelles infrastructures financées par le Qatar sont en effet en construction comme ce grand complexe (cinéma, hôtel, centre commercial) sur une des rives du Nil. La villa personnelle que l’émir du Qatar fait construire dans le cœur historique est tout à fait symbolique du pied-à-terre qatari au Caire. Mais l’image du Qatar englobe en fait une présence économique et financière du Golfe (Koweït, Arabie Saoudite etc.). Pour l’essentiel, la société égyptienne continue de tourner au carburant du marché noir.
Dans le milieu des affaires, tous demandent la sécurité (et en particulier la sécurité juridique) des biens et des investissements. Mais c’est surtout l’absence d’orientation économique clairement identifiée qui pose problème : actuellement, on ne sait pas si l’économie est contrôlée par le gouvernement (comme sous le précédent régime) ou si le gouvernement fait le choix d’une économie libérale. Une ligne de conduite claire en matière économique est cruellement manquante. Or, naturellement, aucun investissement européen ne s’aventurera en Égypte sans savoir au préalable à quel type d’économie il aura à faire. Par ailleurs la menace de banqueroute de l’État pèse sérieusement sur l’économie du pays, dont les élites sont trop facilement persuadées que la taille critique de l’Égypte les préserve d’un état de faillite. A tort… Quelques incidents ont également pu inquiéter ces dernières semaines, comme ces attaques d’entreprises françaises et italiennes de ciment installées dans le Sinaï (juste à côté d’une entreprise militaire égyptienne de ciment !…)…
Néanmoins, l’implantation des 110 entreprises françaises implantées en Égypte (38 000 employés) n’est pas menacée à ce stade. Selon M. Hassan BEHNAM, Président du Bureau UBIFRANCE en Égypte, si on constate une réelle réticence des entreprises à venir s’implanter ou investir, paradoxalement, les entreprises françaises déjà installées ne souhaitent pas partir. Quelques PME ont même ouvert récemment.
Une politique étrangère déséquilibrée
À propos de la Palestine voisine, on peut constater une continuité certaine avec le régime précédent, à la grande satisfaction des Israéliens qui ont prolongé la barrière de sécurité à la frontière égyptienne avec les territoires palestiniens et qui ont constaté que les Frères Musulmans avaient « fait taire » les tirs du Hamas. L’Égypte a même procédé à l’inondation d’un des tunnels de passage d’Hommes et de marchandises. On savait déjà que derrière les discours, il n’y avait pas de solidarité « arabe » à la cause palestinienne ; on constate aussi qu’il n’y a pas plus de solidarité « musulmane ». Et pour cause : le droit des Palestiniens n’est ni une question arabe ni une question musulmane mais une question politique, une question de Droit d’un peuple à disposer de lui-même, de justice et de développement. Mais cela est un autre sujet…
Ce qui me frappe le plus, c’est le déséquilibre de la politique étrangère égyptienne. A l’égard de l’Europe, l’Égypte n’a pas de stratégie manifeste. (Soit dit en passant, l’inverse est aussi vrai.) Ni agressive, ni amicale, elle semble impensée comme si l’Égypte restait marqué, dans sa relation à l’ « Occident », par la prédominance des États-Unis. C’est pourtant avec l’Europe, voisine immédiate, que l’Égypte peut engager une perspective de co-développement. Et ce d’autant qu’à la faveur des évolutions au Maghreb, il est urgent de redéfinir une nouvelle ambition méditerranéenne. Il demeure que l’Égypte ne semble pas tournée vers ses voisins immédiats de l’Ouest et du Nord… Il apparaît même, chose étonnante, que l’Égypte ne cherche pas à se poser comme un acteur africain de première importance, privilégiant une démarche « arabe » c’est-à-dire tournée vers l’Est (pays du Golfe en particulier). A l’heure où l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Maroc et d’autres s’affirment sur une scène africaine en pleine reconfiguration, cette impensé égyptien est surprenant. Peut-être une faute qui peut coûter politiquement et économiquement au peuple égyptien.
Indépendance des associations : un enjeu majeur
Mon séjour fut trop court pour rencontrer autant d’associations, de militants, de jeunes activistes que j’aurais voulu. J’ai eu néanmoins le plaisir d’échanger avec quelques unes (Fondation Nouvelles Femmes, Fédération internationale des droits de l’homme, Fondation Drosos, Caritas Égypte, France Volontaires, Médecins du Monde) et de profiter de leurs éclairages, de comprendre leurs combats et, dans ces quelques lignes, de relayer leurs craintes.
Il existe près de 46 000 ONG en Égypte (tous domaines confondus). Je ne peux pas à ce stade déterminer combien sont nées après la Révolution, mais les alertes sont sans ambiguïté. Leurs difficultés se sont accrues essentiellement depuis 2011, année du procès contre trois grandes ONG américaines, accusées d’être les chevaux de Troie de l’ingérence étrangère en Égypte. Les associations de Droits de l’Homme sont particulièrement visées. De manière générale, les ONG sont confrontées à des tracasseries administratives (par exemple pour la déclaration et l’enregistrement) qui ont pour effet (et sans doute pour objectif) le découragement militant. Une grande difficulté réside également dans les transferts d’argent sur les comptes des ONG, contrôlés par la sécurité nationale, qui doit donner son autorisation préalable, qu’il s’agisse d’ONG locales égyptiennes ou étrangères (une seule et même loi régit le régime de ces ONG).
C’est à tort que cette question est souvent appréhendée comme secondaire : car du degré de liberté des associations dépend une part essentielle de la liberté générale de tous. Pour rappel, 12000 citoyens avaient été mis en prison pendant la période dite de transition (celle qui avait précédé les élections)… La tendance au musèlement ou à l’éclosion des associations est en général un indicateur fiable de l’état des droits et des libertés dans un pays. En Égypte, on est dans l’entre deux : dynamisme et espoir des nouveaux engagements nés dans la révolution, craintes et résignations face aux tentations de contrôle politique…
Les associations rencontrées se battent et ne lâchent rien, mais ont insisté sur la nécessité de poursuivre et d’intensifier les pressions internationales, notamment à travers l’Union Européenne. Pour ma part, je reste persuadé qu’il faut renforcer les conditionnalités démocratiques dans les « aides » qu’apportent les institutions financières internationales.
Soutenir, encourager et relayer le combat des femmes en Égypte
On m’a rapporté plusieurs incidents graves : des femmes battues devant le bureau des Frères musulmans, des jeunes filles sans voile à qui on a coupé les cheveux, et, bien sûr, les horribles viols – souvent collectifs – dont sont victimes des citoyennes égyptiennes. Ces violences physiques viennent s’ajouter à une tradition pré-islamique et pré-chrétienne déjà violente puisque les chiffres les plus effarants me sont données quant à l’excision des jeunes filles, musulmanes et coptes. Je n’ai pas eu moyen de vérifier si, comme je l’ai entendu à plusieurs reprises, près de 90% des égyptiennes non mariées sont concernées, mais il reste que la pratique semble très répandue. Mais c’est, comme souvent, sur le terrain politique que les choses se jouent pour l’avenir. Le combat le plus symbolique porte sur la diminution de l’âge légal du mariage (actuellement 18 ans) à 9 ans qui, bien qu’elle ne fasse pas encore l’objet d’une loi, est devenue possible dans le cadre de la nouvelle constitution.
Deux épisodes majeurs ont marqué la scène politique égyptienne ces dernières semaines :
![]() la marche des femmes le 8 mars 2013 : un millier de femmes égyptiennes ont défilé dans les rues du Caire. « Mères courages » pendant la révolution, elles sont désormais le plus souvent écartées de la nouvelle Égypte. Réunir un millier de femmes étant déjà un exploit, sachant que les femmes ne sont pas habituées à manifester seules. Leur but – mobiliser l’opinion publique à travers cette marche – a été atteint, notamment repris par de nombreux médias internationaux. Mais chacune de ces initiatives est vue par les islamistes comme un moyen de déstabilisation du nouveau pouvoir.
la marche des femmes le 8 mars 2013 : un millier de femmes égyptiennes ont défilé dans les rues du Caire. « Mères courages » pendant la révolution, elles sont désormais le plus souvent écartées de la nouvelle Égypte. Réunir un millier de femmes étant déjà un exploit, sachant que les femmes ne sont pas habituées à manifester seules. Leur but – mobiliser l’opinion publique à travers cette marche – a été atteint, notamment repris par de nombreux médias internationaux. Mais chacune de ces initiatives est vue par les islamistes comme un moyen de déstabilisation du nouveau pouvoir.
![]() Il se trouve que mon déplacement en Égypte s’est effectué au lendemain d’une forte polémique en Égypte : certains ont sans doute suivi qu’une déclaration historique pour les droits des femmes qui dénonce les violences faites aux femmes et définit un code de conduite pour les combattre a été signée le 15 mars 2013 à l’ONU, adoptée par consensus. Or, les Frères musulmans ont déclaré dans un communiqué avant l’adoption de ce texte qu’il conduirait à une « déchéance totale de la société », ils se sont dit opposés à dix points du texte, notamment « l’égalité totale dans la législation du mariage » et « l’annulation de la nécessité de demander l’accord du mari pour voyager, travailler ou utiliser des moyens contraceptifs ». Pour les Frères musulmans, le document donne à la société des « moyens destructifs pour porter atteinte à la famille » notamment en accordant aux filles une « totale liberté sexuelle » et en leur donnant accès à des moyens contraceptifs. Il s’agit de la prise de position la plus explicite des Frères musulmans sur les femmes et leur rôle dans la société, depuis leur arrivée au pouvoir. Alors que la délégation égyptienne avait accepté cette déclaration, Mme Pakinam ELSHARKAWY, Vice-Premier Ministre et Assistante spéciale du Président de l’Égypte chargée des affaires politiques, s’est « invitée » à l’ONU pour émettre la « réserve des spécificités culturelles » des pays. Et, constatant que le texte avait déjà été adopté, elle a ajouté qu’elle « espérait que le texte final n’essaiera pas d’imposer des concepts et des définitions qui ne font pas l’objet d’un accord et qui vont au-delà de l’objet de la session. »
Il se trouve que mon déplacement en Égypte s’est effectué au lendemain d’une forte polémique en Égypte : certains ont sans doute suivi qu’une déclaration historique pour les droits des femmes qui dénonce les violences faites aux femmes et définit un code de conduite pour les combattre a été signée le 15 mars 2013 à l’ONU, adoptée par consensus. Or, les Frères musulmans ont déclaré dans un communiqué avant l’adoption de ce texte qu’il conduirait à une « déchéance totale de la société », ils se sont dit opposés à dix points du texte, notamment « l’égalité totale dans la législation du mariage » et « l’annulation de la nécessité de demander l’accord du mari pour voyager, travailler ou utiliser des moyens contraceptifs ». Pour les Frères musulmans, le document donne à la société des « moyens destructifs pour porter atteinte à la famille » notamment en accordant aux filles une « totale liberté sexuelle » et en leur donnant accès à des moyens contraceptifs. Il s’agit de la prise de position la plus explicite des Frères musulmans sur les femmes et leur rôle dans la société, depuis leur arrivée au pouvoir. Alors que la délégation égyptienne avait accepté cette déclaration, Mme Pakinam ELSHARKAWY, Vice-Premier Ministre et Assistante spéciale du Président de l’Égypte chargée des affaires politiques, s’est « invitée » à l’ONU pour émettre la « réserve des spécificités culturelles » des pays. Et, constatant que le texte avait déjà été adopté, elle a ajouté qu’elle « espérait que le texte final n’essaiera pas d’imposer des concepts et des définitions qui ne font pas l’objet d’un accord et qui vont au-delà de l’objet de la session. »
Un détour par la francophonie
Le réseau bilingue francophone égyptien compte 42000 élèves répartis dans 58 établissements. En Égypte 6000 élèves passent le bac français chaque année. Trois grandes universités proposent aux égyptiens de poursuivre leur formation en français : l’Université Française d’Égypte (UFE) au Caire, l’Université Senghor à Alexandrie en tant qu’opérateur direct de l’OIF et deux filières francophones au sein de l’Université du Caire : l’Institut de Droit des Affaires Internationales (IDAI) et la Filière d’Economie et de Science Politique (FESP).
Parmi les étudiants, certains sont fonctionnaires dans des pays d’Afrique et effectuent au Caire une formation complémentaire en droit, sciences politiques ou économie. Au sein de la filière IDAI, en plus des nationaux égyptiens, différentes nationalités sont représentées, nous avons notamment rencontrées des maliens, guinéens, algériens, français, etc.
Les filières francophones juridiques (IDAI) et économique (FESP) de l’Université du Caire présentent une réelle attractivité pour ceux qui souhaitent étudier le Français dans la région. L’intérêt de ces filières, partenaires d’universités et écoles françaises (La Sorbonne, Science Po) résident notamment dans le fait qu’elles délivrent un double diplôme : de l’Université du Caire et le diplôme français.
Cette excellence de l’enseignement du français en Égypte ne doit néanmoins pas nous faire oublier que la langue française occupe une place tout à fait secondaire en Égypte, où elle n’est pas une langue véhiculaire, mais un marqueur social fort. Un signe d’élitisme. C’est pourquoi l’idée de développer des jardins d’enfants francophones émerge, dans une perspective de démocratisation de l’accès à la langue française.
Si l’immersion linguistique s’accompagne d’un désir de séjour dans un pays francophone (France, Belgique, Maroc, Algérie, Canada, etc.) pour acquérir une expérience, le retour en Égypte est une certitude pour la plupart des étudiants que j’ai rencontrés. Ces jeunes ont en effet un très fort sens du « devoir » envers leur pays qui est en pleine transition et aura besoin de ses « reconstructeurs » du futur.
C’est précisément avec cette génération que la France peut et doit développer des relations amicales durables. Déjà, à travers l’Institut français, la relation est concrète : grâce aux cours de langues (français et arabe) les actions de coopération sont très ciblées et la relation très pragmatique : administration, justice, institutions culturelles, etc.