Après avoir dénoncé le 15 février avec beaucoup de facilité la rencontre entre une délégation de parlementaires français et le président du parti Nahda, et après que j’eus réagi une première fois, Jean-Luc Mélenchon remettait cela dans une tentative hasardeuse d’explication, faisant le choix de s’en prendre explicitement à moi-même. Agressif et méprisant. Inutilement.
Voilà pourtant plusieurs années qu’au gré de nos différentes rencontres (et de nos combats communs), je lui propose de débattre de la situation au Maghreb, où je me rends régulièrement depuis de nombreuses années, avec les opposants à Ben Ali avant 2011, avec les démocrates depuis. Cette discussion, je la mène avec chacun de mes camarades de gauche, sans exception, car la Gauche doit non seulement confronter ses analyses de ce qui a été baptisé le «Printemps arabe», mais elle doit aussi réfléchir aux perspectives géopolitiques ouvertes par la Révolution sociale et citoyenne de Tunisie.
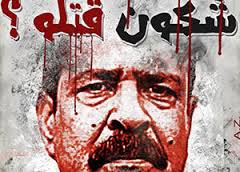 Je prends donc la plume à mon tour, en faisant le pari que l’histoire immédiate tunisienne – qui est également la nôtre – intéressera au-delà du cercle des amateurs de polémiques inutiles et, pour tout dire, mortifères. Car ce qui habite le co-président du Parti de Gauche c’est d’abord, semble-t-il parfois, une obsession hostile au Parti socialiste qui oscille entre paranoïa et procès systématique et qui le conduit à prendre de manière quasi pavlovienne l’oblique du Parti socialiste, sur tous les sujets. Obsession visible jusque dans le titre de son premier communiqué de presse : «PS-Nahda: l’inacceptable rencontre». En agissant de la sorte, entre mauvaise foi et arrangements avec la vérité, il contribue à l’affaiblissement de l’ensemble de la gauche, qui ne lui profitera pas. Cette méthode ne mènera qu’à l’échec de nos convictions communes. Et, pendant qu’en Tunisie comme en France, on s’accuse matin et soir, les intégristes là-bas et les nationalistes ici avancent, organisés.
Je prends donc la plume à mon tour, en faisant le pari que l’histoire immédiate tunisienne – qui est également la nôtre – intéressera au-delà du cercle des amateurs de polémiques inutiles et, pour tout dire, mortifères. Car ce qui habite le co-président du Parti de Gauche c’est d’abord, semble-t-il parfois, une obsession hostile au Parti socialiste qui oscille entre paranoïa et procès systématique et qui le conduit à prendre de manière quasi pavlovienne l’oblique du Parti socialiste, sur tous les sujets. Obsession visible jusque dans le titre de son premier communiqué de presse : «PS-Nahda: l’inacceptable rencontre». En agissant de la sorte, entre mauvaise foi et arrangements avec la vérité, il contribue à l’affaiblissement de l’ensemble de la gauche, qui ne lui profitera pas. Cette méthode ne mènera qu’à l’échec de nos convictions communes. Et, pendant qu’en Tunisie comme en France, on s’accuse matin et soir, les intégristes là-bas et les nationalistes ici avancent, organisés.
 Voilà d’abord ce qui me mit en colère, alors que nous étions tous encore en plein deuil de l’exécution de Chokri Belaïd: en cherchant volontairement à semer la confusion, en teintant celle-ci d’une calomnie grave (et à la vérité dégueulasse : pensez-vous, le PS soutient Nahda!), Mélenchon s’inscrit dans une démarche totalement contraire à l’esprit de controverse argumentée. Et appauvrit lui-même la force de son analyse. C’est aussi mesquin que si quelqu’un lui avait reproché de se compromettre avec Bashar al-Assad quand il l’accueillit en juin 2001, au nom du gouvernement français, à l’aéroport. Ou si on l’accusait d’être un complice du régime des mollahs quand il serre la main de Chavez, au prétexte que celui-ci est un allié de celui-là. Ou encore que son remarquable silence fut coupable quand Ben Ali faisait torturer ses opposants – laïcs et religieux – tandis que son clan s’appropriait les ressources du pays. Nul besoin d’aller sur ce terrain. Reprenons les arguments pour en venir au fond.
Voilà d’abord ce qui me mit en colère, alors que nous étions tous encore en plein deuil de l’exécution de Chokri Belaïd: en cherchant volontairement à semer la confusion, en teintant celle-ci d’une calomnie grave (et à la vérité dégueulasse : pensez-vous, le PS soutient Nahda!), Mélenchon s’inscrit dans une démarche totalement contraire à l’esprit de controverse argumentée. Et appauvrit lui-même la force de son analyse. C’est aussi mesquin que si quelqu’un lui avait reproché de se compromettre avec Bashar al-Assad quand il l’accueillit en juin 2001, au nom du gouvernement français, à l’aéroport. Ou si on l’accusait d’être un complice du régime des mollahs quand il serre la main de Chavez, au prétexte que celui-ci est un allié de celui-là. Ou encore que son remarquable silence fut coupable quand Ben Ali faisait torturer ses opposants – laïcs et religieux – tandis que son clan s’appropriait les ressources du pays. Nul besoin d’aller sur ce terrain. Reprenons les arguments pour en venir au fond.
Tout d’abord, il apparaît nécessaire de faire une première observation. Il commet une erreur, et à mon avis une faute, commise par d’autres responsables politiques ou éditoriaux de tous bords, en réduisant l’enjeu en Tunisie à un affrontement entre laïcs et religieux. Par exemple, Manuel Valls et Jean-Luc Mélenchon partagent une même approche de l’islam politique tunisien, qualifié de «fascisme» par le premier et d’«extrême droite religieuse» par le second. Je comprends leur idée et, pour être exact, j’en partage le substrat: les intégristes sont des ennemis de l’Humanité. Mais d’une certaine manière ils tombent dans un piège car cette grille de lecture, en partie imposée par les mouvements islamistes eux-mêmes, enferme les démocrates et les républicains dans un débat identitaire dont ils veulent précisément sortir. J’ai déjà exposé cela en pleine polémique au sujet de la publication de nouvelles caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo. La révolution tunisienne, faut-il le rappeler, fut et reste une révolution sociale. L’urgence est sociale et démocratique, pas identitaire. Ce qui se joue en Tunisie, c’est aussi – contre les apparences – de rendre possible la fin du cycle de l’islam politique ouvert par le coup d’Etat religieux opéré en pleine Révolution iranienne[«[Téhéran, Tunis, d’une révolution à l’autre» – Pouria Amirshahi publié dans Médiapart le 17 janvier 2011.]]
 J’en viens à la mission parlementaire mise en cause, à laquelle je n’ai pas pris part, retenu en France. Au début de la législature, la commission des Affaires étrangères a proposé la création de plusieurs missions d’information: sur le Sahel, l’Algérie, la Francophonie, les révolutions arabes, etc. Ceux qui me lisent régulièrement comprennent que cet agenda me satisfait au plus haut point, tant ces missions, liées entre elles, font sens dans la période historique actuelle. La paresse intellectuelle, les errements politiques et souvent les renoncements de ces dernières années ont creusé un fossé entre la France et l’Afrique alors même qu’il faut construire des ponts. Mobilité des personnes, projets industriels communs, échanges culturels, les dossiers à rouvrir sont légions.
J’en viens à la mission parlementaire mise en cause, à laquelle je n’ai pas pris part, retenu en France. Au début de la législature, la commission des Affaires étrangères a proposé la création de plusieurs missions d’information: sur le Sahel, l’Algérie, la Francophonie, les révolutions arabes, etc. Ceux qui me lisent régulièrement comprennent que cet agenda me satisfait au plus haut point, tant ces missions, liées entre elles, font sens dans la période historique actuelle. La paresse intellectuelle, les errements politiques et souvent les renoncements de ces dernières années ont creusé un fossé entre la France et l’Afrique alors même qu’il faut construire des ponts. Mobilité des personnes, projets industriels communs, échanges culturels, les dossiers à rouvrir sont légions.
Les mouvements révolutionnaires au Maghreb et au Proche-Orient appartiennent à la même séquence historique que la chute du Mur de Berlin ou que l’affirmation des démocraties en Amérique latine. C’est la thèse que je défends. En l’occurrence, pour ce qui concerne la rive sud de la Méditerranée, les parlementaires français doivent comprendre et écouter l’ensemble des acteurs. C’est ce qu’ils ont fait: les progressistes d’abord (de manière très malhonnête, Mélenchon ne fait pas état de ces rencontres), mais aussi des tenants de la Réaction. Il fallait et faut le faire d’autant plus qu’il existe au sein de Nahda des démocrates-musulmans, comme il a existé, et existe encore en Europe des démocrates-chrétiens. N’en déplaise à Mélenchon, autant qu’à moi-même d’ailleurs. Il faut avouer que j’ai mis du temps à admettre cela. Je sais d’où je viens, chacun comprendra. Bref, tous les groupes parlementaires ont été sollicités ainsi que tous les chefs de partis acteurs de la Constituante. Rached Ghannouchi est de ceux-là. Au passage, puisqu’il s’est appliqué à nous décrire son pédigrée islamo-radical, il est dommage qu’il ait oublié de rappeler que ce  dernier fut aussi un temps un fervent partisan du nassérisme, c’est-à-dire du nationalisme panarabe laïc. En Tunisie, comme ailleurs, la réalité est souvent plus complexe que la façon dont on veut nous la présenter.
dernier fut aussi un temps un fervent partisan du nassérisme, c’est-à-dire du nationalisme panarabe laïc. En Tunisie, comme ailleurs, la réalité est souvent plus complexe que la façon dont on veut nous la présenter.
Chacun aura noté que Jean-Luc Mélenchon évoque une délégation «conduite par le PS». C’est faux, et cela relève de la parfaite mauvaise foi. Ancien sénateur, aujourd’hui député européen, il ne peut ignorer que les délégations parlementaires ne sont ni conduites, ni composées par un parti. C’est ès-qualité, en tant que présidente de la commission des Affaires étrangères qu’Élisabeth Guigou a conduit la délégation composée de parlementaires de l’UMP et…du Front de Gauche (en l’occurrence représenté par le député François Asensi, qui n’a d’ailleurs guère apprécié cette sortie pour le moins déloyale). Que chacun sache – il faut bien effacer l’ignoble accusation – qu’il va de soi qu’une délégation du seul parti socialiste n’aurait eu pour interlocuteurs que des partis de gauche[«[Délégation du PS en Tunisie: nous avons essayé de donner une autre image de la France» – Pouria Amirshahi, interview sur Public-Sénat le 4 février 2011.]]. Et pas uniquement ceux d’Ettakatol. Mes derniers déplacements le prouvent.
Mais c’est surtout à l’égard des Tunisiens eux-mêmes que les propos de Mélenchon sont décalés. Ce qui est certain en effet, c’est que les partis de la gauche tunisienne, et au-delà, s’affrontent, se confrontent et… discutent tous les jours avec Nahda. Ces relations datent même d’avant la Révolution. D’ailleurs, quand, le 18 octobre 2005, Nahda, le PCOT, le PDP, le CPR et des personnalités indépendantes se réunissaient avec comme objectif commun l’établissement d’une démocratie où pourraient coexister tous les mouvements, y compris islamistes[Pour une approche de cette alliance, lire l’article paru dans Afrique en Luttes: [2005-2010 : LA CONSTRUCTION D’UNE ALLIANCE LARGE POUR UN CHANGEMENT DÉMOCRATIQUE EN TUNISIE Collectif du 18 octobre pour les Droits et les Libertés en Tunisie – Paris]], qu’a dit Mélenchon, alors dirigeant et sénateur socialiste ? Rien.
J’en viens au point le plus passionnant, mais que Mélenchon a, là aussi, traité avec la désinvolture du procureur : le choix d’Ettakatol[-Parti proche du Parti socialiste français, membre de l’Internationale socialiste]] de participer à un gouvernement aux côtés de Nahda et du CPR-[1]. Je note au passage que le courage auquel m’invite Mélenchon s’arrête à son blog: a-t-il seulement fait ce reproche aux membres du CPR qu’il a rencontrés à Tunis, à commencer par son président ? Non. Il n’a rien dit. Bref, ne perdons pas de vue l’essentiel: fallait-il une telle alliance ? Je me suis plusieurs fois exprimé à ce sujet, de façon assez critique pour que je me permette ici de dire les choses avec plus de recul. Au lendemain de la Révolution, le vrai pouvoir se situe à l’Assemblée nationale constituante (ANC). Le gouvernement est un lieu – en théorie – de gestion des affaires courantes jusqu’aux élections prévues initialement le 23 octobre 2012. Toutes les forces progressistes, sans exception, se sont ouvertement interrogées sur l’hypothèse d’une stratégie de contrôle de Nahda – qui avait recueilli plus de 35% des suffrages. Tous les démocrates se sont posé la question : faut-il laisser les islamistes gouverner seuls… ou non ? Quels sont les risques dans un cas, les garanties dans l’autre ?
 Tels étaient alors les termes du débat. Et d’ailleurs, il s’était trouvé alors une majorité de députés démocrates et républicains de l’ANC pour faire ce choix en 2011. Je livre maintenant mon point de vue, déjà transmis à tous mes amis tunisiens depuis deux ans, quels qu’aient été leurs choix : la stratégie révolutionnaire la plus efficace eut sans doute été de contenir les réflexes hégémoniques de Nahda au sein du gouvernement – non seulement en surveillant le Premier ministre mais en limitant strictement le rôle du gouvernement à la gestion courante – et, au sein de l’ANC, de construire une majorité constitutionnelle afin de garantir tout à la fois les acquis de Bourguiba et ceux de la Révolution. Malheureusement, les démocrates ont été incapables de s’unir, tandis que Nahda a tissé sa toile sans opposition construite. Le morcellement est inquiétant. Il est encore temps de se ressaisir, d’autant que l’UGTT ne pourra indéfiniment tenir seule le front et que la société civile est sans perpective politique et sans débouché électoral. Pourtant, les partisans de l’Etat de Droit restent majoritaires en Tunisie[2].
Tels étaient alors les termes du débat. Et d’ailleurs, il s’était trouvé alors une majorité de députés démocrates et républicains de l’ANC pour faire ce choix en 2011. Je livre maintenant mon point de vue, déjà transmis à tous mes amis tunisiens depuis deux ans, quels qu’aient été leurs choix : la stratégie révolutionnaire la plus efficace eut sans doute été de contenir les réflexes hégémoniques de Nahda au sein du gouvernement – non seulement en surveillant le Premier ministre mais en limitant strictement le rôle du gouvernement à la gestion courante – et, au sein de l’ANC, de construire une majorité constitutionnelle afin de garantir tout à la fois les acquis de Bourguiba et ceux de la Révolution. Malheureusement, les démocrates ont été incapables de s’unir, tandis que Nahda a tissé sa toile sans opposition construite. Le morcellement est inquiétant. Il est encore temps de se ressaisir, d’autant que l’UGTT ne pourra indéfiniment tenir seule le front et que la société civile est sans perpective politique et sans débouché électoral. Pourtant, les partisans de l’Etat de Droit restent majoritaires en Tunisie[2].
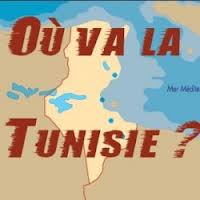 Il est encore temps aussi pour nous, la gauche française, de réfléchir ensemble à une stratégie d’appui et de soutien aux forces démocratiques[Par exemple, avec des initiatives comme celle-ci: « [Appel international pour la Tunisie – Contre la violence politoque et pour la poursuite du processus démocratique« ]]. Pour cela, sans doute faut-il une autre façon de dialoguer, préférer le débat argumenté à l’invective. Sans aucun doute, la gauche doit se réorganiser à l’échelle mondiale et tourner le dos aux deux césures qui la matricent depuis trop longtemps : la division entre socialistes et communistes – héritage de la préhistoire – et l’étanchéité entre les « internationales » politiques et les mouvements sociaux internationaux (Forum social mondial par exemple). Cela permettra, par la même occasion, que chacun fasse le ménage chez soi, ce qui, à l’Internationale socialiste, ne sera pas inutile. Tu vois, Jean-Luc: on peut rester respectueux et critique, même dans la controverse. Pour la gauche, c’est mieux…
Il est encore temps aussi pour nous, la gauche française, de réfléchir ensemble à une stratégie d’appui et de soutien aux forces démocratiques[Par exemple, avec des initiatives comme celle-ci: « [Appel international pour la Tunisie – Contre la violence politoque et pour la poursuite du processus démocratique« ]]. Pour cela, sans doute faut-il une autre façon de dialoguer, préférer le débat argumenté à l’invective. Sans aucun doute, la gauche doit se réorganiser à l’échelle mondiale et tourner le dos aux deux césures qui la matricent depuis trop longtemps : la division entre socialistes et communistes – héritage de la préhistoire – et l’étanchéité entre les « internationales » politiques et les mouvements sociaux internationaux (Forum social mondial par exemple). Cela permettra, par la même occasion, que chacun fasse le ménage chez soi, ce qui, à l’Internationale socialiste, ne sera pas inutile. Tu vois, Jean-Luc: on peut rester respectueux et critique, même dans la controverse. Pour la gauche, c’est mieux…

